« Dans une dizaine d’années, nous pouvons espérer des traitements qui amélioreront les séquelles de la Sep »

Progrès dans le diagnostic désormais plus précoce, travaux sur les traitements des séquelles de la Sep ou encore meilleure formation des patients. À l’occasion de la journée mondiale de la sclérose en plaques, le point sur dernières avancées de la recherche avec le neurologue Jean Pelletier*, responsable du Centre de ressources et de compétences Sep de Marseille.
 Faire-face.fr : Dans quels domaines la recherche sur la Sep a-t-elle le plus progressé ces dernières années ?
Faire-face.fr : Dans quels domaines la recherche sur la Sep a-t-elle le plus progressé ces dernières années ?
Jean Pelletier : La sclérose en plaques est une maladie auto-immune, touchant à la fois le cerveau, la moelle épinière et le nerf optique. Dès lors, la recherche se focalise beaucoup sur la détermination des mécanismes qui causent l’apparition de la maladie et participent à l’atteinte de la myéline, cette gaine qui entoure et sert à protéger les fibres nerveuses. Cela permettrait de mieux comprendre la survenue des lésions inflammatoires. Et donc de réaliser des diagnostics plus précoces.
Mais déjà, cette dernière décennie, nous avons beaucoup progressé dans le diagnostic. En effet, les IRM détectent désormais plus sûrement les lésions de la Sep. De plus, elles nous permettent de mieux prédire si la maladie sera agressive ou pas. Si la première IRM montre beaucoup de lésions ou une grande activité inflammatoire, on sait qu’il existe un risque de handicap plus sévère à long terme. Bientôt, des outils d’intelligence artificielle pourraient nous aider à comparer les IRM successives des patients pour mieux pronostiquer l’évolution possible de la pathologie. Pour le moment, des études sont en cours pour évaluer leur fiabilité.
F-f.fr : Et en matière de traitements, y a-t-il eu aussi des améliorations ?
J.P : Poser un diagnostic plus tôt diminue nettement le risque pour les patients de développer un handicap dans les dix ou quinze ans qui suivent. En effet, avec un traitement plus précoce et plus adapté aux symptômes précis du patient, le risque de handicap à long terme diminue. Concernant la forme rémittente, la plus classique, celle qui évolue par poussées, nous disposons déjà de molécules très efficaces pour bloquer l’inflammation, éviter les poussées et l’apparition de nouvelles lésions.
En revanche, pour la forme progressive, nous demeurons assez démunis. Aujourd’hui, la recherche vise particulièrement deux objectifs. D’abord, une meilleure prise en charge cette forme progressive et la recherche de moyens pour réparer les séquelles, quelle que soit la forme de la maladie.
On parle souvent de remyélinisation. Mais la myéline est le transmetteur du courant électrique. La réparer ne suffit pas. Il faut aussi rétablir le fonctionnement du fil électrique que sont les axones, les fibres nerveuses des neurones. Nous commençons à avoir des pistes pour les protéger ou remyéliniser. Je dirais que dans une dizaine d’années, nous pouvons espérer des traitements qui amélioreront les séquelles de la Sep.
F-f.fr : Aux côtés de cette recherche fondamentale et clinique, se développent des travaux en sciences humaines. Dans quel but ?
J.P : Celui de comprendre le vécu des patients et de tenter de l’améliorer. En particulier pour la prise en charge des trois principaux symptômes invisibles que sont la fatigue, les problèmes sphinctériens urinaires et les troubles cognitifs. Les programmes d’éducation thérapeutique leur ont permis de mieux se former et s’informer. Une façon pour eux de mieux s’approprier la maladie, notamment pour certains en devenant patients experts.
Récemment née de la fusion entre l’Arsep, la Ligue française contre la sclérose en plaque (LFSEP) et l’Unisep, FRANCE Sep comptera d’ailleurs trois comités. Un de patients et aidants, un médico-scientifique et un troisième, justement focalisé sur les questions de formation et d’information. Ce dernier rassemblera des patients, kinés, médecins et de nombreux acteurs impliqués dans la prise en charge des patients. Et fera la jonction entre les deux autres pour améliorer et transmettre les connaissances à toutes les personnes concernées par la Sep. Grâce au lancement de FRANCE Sep), nous espérons être plus forts, plus efficaces, et décrocher plus de fonds consacrés à la recherche sur la Sep.
* Centre installé au sein du service de neurologie et maladies inflammatoires du cerveau et de la moelle épinière (MICeME), CHU Timone. Également du Comité médico scientifique de France Sep.
Le Point sur la sclérose en plaques et les maladies apparentées en 2024 – 250 pages – Édité par FRANCE Sep Gratuit. Pour le commander.

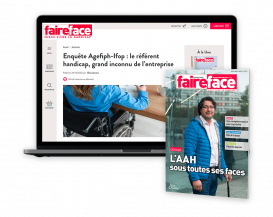
Vos avantages :
- Magazine téléchargeable en ligne tous les 2 mois (format PDF)
- Accès à tous les articles du site internet
- Guides pratiques à télécharger
- 2 ans d’archives consultables en ligne
A lire également

Quatre idées reçues (et fausses) sur la trisomie 21


 Faire Face
Faire Face 






Effectivement, la plupart des malades de la SEP seront morts d’ici que la science découvre un moyen de les guérir !
Les chercheurs du domaine de la SEP n’avancent pas et c’est bien regrettable ; contrairement à l’intelligence artificielle qui a de beaux jours devant elle !
Les neurologues n’apportent rien à leurs patients, dès que les patients se plaignent de leur état ; ils leurs proposent d’aller voir un psychologue ! Ils se déchargent. Il faut avoir la SEP pour se rendre compte de la maladie. Les neurologues vous font faire des IRM pour faire un constat , et alors à quoi cela va servir à part avoir un bilan sans remèdes à la clé ! Les traitements actuels sous forme de seringues, vous créent des hématomes très douloureux après injection du produit, des effets indésirables (foie endommagé, prises de sang regulières pour contrôler les dommages du produit) allant jusqu’à la paranoïa, voire la folie sans empêcher les crises éventuelles.
Irm c est du constat
Cela ne sert à rien puisqu il n y a pas de médicaments à part des plqures dont l efficacité n est réelle que par la modelisation
On est bon qu’à remplir les caisses des labos !!